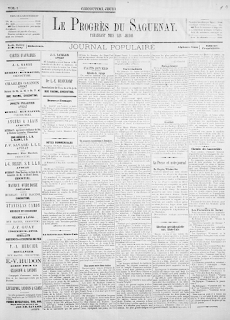Le Nouvelliste / La Voix de l'Est / Le Droit
Le Nouvelliste Le Nouvelliste est fondé en 1920 par Joseph Herman Fortier , qui en sera le propriétaire jusqu’en 1935. Fortier est le vice-président et directeur général des magasins à succursales P.T. Légaré, basés à Québec et possède le journal L’Événement . Il achète une feuille déjà existante, Le Trifluvien et le transforme en nouveau journal, Le Nouvelliste , dont le premier numéro paraît le 30 octobre. Il a pour objectif de promouvoir la langue française, les traditions de l'Église et le développement économique et industriel de la région. Le Nouvelliste en mai 1921 En 1935, alors que les magasins P.T. Légaré font faillite, Fortier vend Le Nouvelliste au sénateur libéral Jacob Nicol , qui est le fondateur de La Tribune et le propriétaire du Soleil et de l ’Événement de Québec. Ce dernier verra donc à restreindre l’influence du Nouvelliste à la Mauricie pour ne pas concurrencer ses autres journaux, tous d'allégeance libérale. À cause de ses positions...